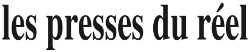Pour leur première collaboration, Marc Baron et Éric La Casa ont décidé d'interroger la représentation sous l'angle de la « contrefaçon », afin de penser notre relation à l'enregistrement et à l'archive. Il s'agit de contrer la façon de fixer le réel, comme pour se défaire de tout réalisme.
« En septembre 2023, dans les laboratoires Hiventy à Joinville-le-pont – anciennement Pathé – nous avons enregistré les processus de restauration (images et son) et de développement de films. En suivant les procédés mécaniques et numériques, nous avons écouté et interrogé les techniciens de façon à comprendre ce qui se joue avec la restauration d'un film. Comment retrouver l'état originel ? Pour cela il est nécessaire de s'approcher de ce que les spectateurs du film à restaurer pouvaient percevoir en salle. Notre regard et notre écoute d'un film ont bien évolué, depuis la naissance du cinéma. Aujourd'hui, ne seraient-ils pas en demande d'une copie 8K dolby atmos ? Nous sommes désormais habitués à une image et un son numériques de plus en plus précis. Ainsi, la version première d'un film sur support analogique qui semblait cette archive et ce point fixes dans notre mémoire, n'est en fait qu'un fragile souvenir dans un réel en constante évolution.
A partir de nos enregistrements de terrain, dans les petites pièces des laboratoires, nous avons procédé à des sessions de réécoutes destructives. Marc, avec ses bandes magnétiques, ses traitements analogiques voire mécaniques (la démagnétisation), et ses multiples haut-parleurs, les met en abime dans l'espace de son studio. Simultanément, Eric enregistre tout autant ce moment où l'original réécouté commence à se transformer voire à disparaître que sa réapparition dans l'espace du studio de Marc. Notre écoute dynamique produit un jeu permanent avec les gestes et les espaces du laboratoire et notre propre studio. A chaque instant, nous explorons les multiples représentations possibles du monde contenu dans l'écoute d'un seul enregistrement.
Comment les outils de l'enregistrement et de la restauration sonores tentent de représenter le monde, alors même que la matérialité de ce monde ne cesse de se transformer ? »
Marc Baron (né en 1981) est un musicien et un compositeur de musique pour haut-parleurs basé à Paris. Son travail est essentiellement lié à une pratique de studio. Ses outils sont principalement analogiques : si les magnétophones sont au centre de sa pratique, l'ordinateur en constitue la marge. Il compose à partir des spécificités du support magnétique, et cherche dans l'épaisseur du bruit de la bande à fabriquer des formes qui mélangent réalisme abimé et flou sonore le plus total. Il entretient un rapport quotidien avec la prise de son, essentiellement intime et domestique : pratique du retrait et de l'indécision pour le compositeur.
Marc Baron a collaboré avec
Mark Vernon,
Jean-Philippe Gross, Lucio Capece,
Jean-Luc Guionnet,
Bertrand Denzler, Stéphane Rives...
Ses travaux ont été publiés sur les labels Cathnor Records, Potlatch, Moremars, Erstwhile Records, Glistening Examples.
« Il y a les sons que je collecte, ceux que je fabrique, il y a ce que j'établis en amont par des protocoles et que je projette. Surtout, tout ce qui vient là, à mes oreilles, parfois par hasard, lorsque la matière est travaillée dans le studio, par la bande, par le microphone. Au départ, aucun son ne m'intéresse plus qu'un autre, je vais simplement là où je pense sentir quelque chose et je creuse. La forme que tout cela prend (diffusion, performance, disque) dépend essentiellement de la musique elle-même. Lorsque cela a du sens, l'espace ou le contexte de diffusion peuvent aussi déterminer des choses. La complexité des qualités, leur assemblage, est le fond-même de ma musique ; prise entre un réalisme d'apparence et le désir du plus grand flou. Je cherche une tension. »
Depuis le milieu des années 1990, à l'écoute de l'environnement, Éric La Casa (né en 1968 à Tours, vit et travaille à Paris) interroge la perception du réel et élargit la question du musical aujourd'hui. Par son approche esthétique de la prise de son, son travail s'inscrit tout autant dans les champs de l'art sonore que de la musique. Conséquences de ses processus in-situ d'écoute, il crée des formes (d'attention) qui s'insinuent dans les sites, y infusent lentement et en deviennent d'autres espaces possibles. De même que la carte stimule la lecture d'un pays, l'objet esthétique in situ renouvelle notre relation à l'espace et au paysage.