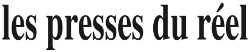Une contre-histoire de l'art contemporain, où l'expérience devient forme, et où l'esthétique se redéfinit comme relation radicale avec le vivant.
Ce livre déploie une constellation d'essais qui, à la manière de figures en marge, esquissent une contre-histoire de l'art contemporain – ou plutôt une pluralité de contre-histoires. À travers l'examen de cas singuliers – tels que les théories cybernétiques de
Jack Burnham ou d'Abraham Moles, les actions invisibles dans l'espace urbain, les stratégies sonores héritées de
John Cage, les résurgences du maniérisme, ou encore les automates et machines conçus par des artistes et designers – il s'agit de tracer les contours d'un art qui, loin de se replier sur l'objet ou sur le cadre institutionnel, cherche à réinventer son rapport au monde, et qui n'est plus composé de tableaux, sculptures ou installations, mais de labyrinthes, de jardins et de robots.
Ce fil rouge est guidé par un impératif commun : dépasser l'asymétrie constitutive de la relation sujet-objet. Les œuvres analysées ne proposent pas seulement des formes artistiques, mais des modèles de mondes – des agencements où l'art n'est plus séparé de la nature mais l'intègre comme condition interne. Dans ce geste, l'observateur cesse d'être extérieur : il devient composant de l'œuvre, et plus largement, de la société envisagée comme milieu d'expérimentation esthétique.
Là où l'art moderne opposait souvent la nature à la culture, ces pratiques contemporaines opèrent un renversement fondamental : elles refusent la dialectique de l'altérité pour proposer une logique de la métamorphose et de la composition partagée. La nature y est pensée non comme origine, mais comme
destination commune – un lieu de résonances, de reconnaissances, d'alliances.
Dans un contexte marqué par la crise écologique et la remise en question des grands partages modernes, ces formes d'art anticipent une politique possible de la nature – ou mieux encore, un laboratoire expérimental de la
nature comme société. Un art qui ne se veut ni illustratif ni spéculatif, mais opératoire : un art où l'expérience devient forme, et où l'esthétique se redéfinit comme relation radicale avec le vivant.
Emanuele Quinz (né en 1973) est historien de l'art et du design, professeur à l'Université Paris 8 et enseignant-chercheur à l'
École nationale supérieure des Arts décoratifs. Ses recherches explorent les convergences entre les disciplines dans les pratiques artistiques contemporaines : des
arts plastiques à la
musique, de la
danse au
design. A la recherche, il associe la pratique de commissaire d'expositions.
Emanuele Quinz codirige les collections
Design/Théories et
Médias/Théories aux Presses du réel. Parmi ses publications :
Le Cercle invisible. Environnements, systèmes, dispositifs (Les presses du réel, 2017),
Le comportement des choses (dir., Les presses du réel, 2021),
Strange Design (dir., avec J. Dautrey, Les presses du réel, 2024),
Ars naturans (Les presses du réel, 2025).