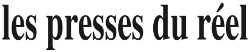L'
art brut avant l'Art Brut : un inventaire archéologique de la beauté bizarre des jardins populaires et des architectures improbables, palais, chalets et châteaux dans les arbres, chapelles et grottes aménagées, maquettes en béton et en allumettes, mobiliers rustiques et sculptures animalières, roulottes et bicyclettes volantes, calvaires... et dernières demeures de créateurs en tout genre (malades mentaux, abbés, bistrotiers, facteurs – Cheval –, ou artistes autoproclamés), aux alentours de 1900. L'iconographie abondante est exclusivement constituée à partir des cartes postales anciennes, uniques documents sur ces sites aujourd'hui pour la plupart disparus, et véritables véhicules des messages esthétiques et éthiques de leur créateur.
L'inventaire exemplaire des architectures bizarres en France – tels que le « Palais idéal » du facteur Cheval et « l'Église vivante et parlante » de Ménil-Gondouin – coïncide autour de 1900 avec l'apparition de la rocaille (en ciment de Portland) et de la carte postale. C'est elle qui va contribuer à populariser les sites.
Commémorer temps révolus et fugacité de l'être s'imposent dans le temps incertain des guerres de 1870, de 1914-1918 et l'horizon de 1939. Qu'il s'agisse de malades mentaux sous la direction d'un aliéniste, de curés et d'hommes politiques en quête de voix plus ou moins égarées, de maçons, de bistrotiers, d'imagiers, de peintres et de sculpteurs autoproclamés, s'exprime le désir d'étonner, de distraire, de marquer les esprits et pas seulement de laisser une trace comme un prisonnier aux murs d'une prison ou un ermite aux parois d'une carrière abandonnée.
La passion archéologique guide les faiseurs de fausses ruines, de folies, de fabriques, de grottes artificielles, de châteaux monumentaux, de maquettes en matériaux divers, de musée. D'autres préfèrent renouer avec un nomadisme ancestral quand ils n'y sont pas précipités par la force des choses : toujours l'ombre de la guerre passe, effrayante. Et la Mort.
« L'originalité de ce livre qui fera date est qu'il fonde la visibilité de son corpus sur un support iconographique essentiel à la mémoire populaire, les cartes postales qui, seules, témoignent encore, de leur invention en 1865 jusqu'aux années 1960 du siècle suivant, de ce riche autant qu'éphémère patrimoine. La recherche est prodigieuse, tant textuelle que visuelle. Cherchant à redonner vie à ce qu'il appelle joliment un "argot de l'art", Décimo, mine de rien, ébranle les fondations d'une histoire canonique et élitaire, comme
Duchamp, dont il est par ailleurs un spécialiste, l'avait fait de celles de l'art lui-même. Rien de révisionniste toutefois dans sa démarche, plutôt la volonté d'élargir les critères d'élection des créations humaines à l'histoire des objets symboliques d'origine populaire et, ce faisant, de soumettre à la critique certains attendus de ce que l'on appelle le goût. »
Jean-Marc Huitorel,
Critique d'art
Professeur d'histoire de l'art contemporain à Paris-X Nanterre, Régent du Collège de
'Pataphysique
(chaire d'Amôriographie littéraire, ethnographique et
architecturale), Marc Décimo (né en 1958) est linguiste, sémioticien et
historien d'art. Il a publié un vingtaine de livres et de nombreux
articles sur la sémiolologie du fantastique, sur les
fous
littéraires (
Jean-Pierre Brisset
– dont il a édité l'
œuvre
complète aux Presses du réel –,
Paul
Tisseyre Ananké) et sur l'
art
brut, sur
Marcel Duchamp (
La
bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être,
Marcel Duchamp mis à nu,
Le Duchamp facile, les
mémoires de
Lydie Fischer
Sarazin-Levassor,
Marcel Duchamp et
l'érotisme) et sur l'histoire et
l'épistémologie de la
linguistique.