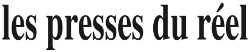Une conversation au long cours avec le philosophe Sylvère Lotringer, fondateur de Semiotext(e), homme de l'ombre ayant œuvré entre l'Europe et les États-Unis à défaire les académismes, instaurer des intelligences collectives et déplacer les lignes entre savoirs et expériences en instaurant les «
Cultural Studies » qui ont révolutionné l'articulation des sciences humaines.
En 1974 à New York, Sylvère Lotringer, un jeune philosophe français fraichement engagé à Columbia University, décide de démarrer une revue avec ses étudiant·e·s.
Semiotext(e) devient rapidement une courroie de transmission entre les divers courants de la pensée critique de l'après 68 français et les États-Unis et s'émancipe de l'université pour s'ouvrir sur toutes les contre-cultures du moment. Le sémioticien Lotringer se réinvente en éditeur, en intervieweur, mais aussi en cinéaste et en catalyseur de toute une scène artistique et intellectuelle alternative qui contribue, un peu par hasard, à instaurer les « Cultural Studies » au cours des années 1980. Avec l'autrice Chris Kraus, Lotringer ouvre la maison d'édition Semiotext(e) à la poésie et à la fiction de nombreuses autrices américaines. Dans cet entretien au long cours donné à une autre collectivité étudiante (un groupe d'étudiant·es de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, animé par François Aubart et François Piron), Sylvère Lotringer raconte l'histoire d'une aventure éditoriale encore vivante aujourd'hui et des manières de faire qu'il a développées pour maintenir pendant 40 ans une ligne politique fidèle en amitiés et attentive aux pulsations du monde contemporain.
« Le ton est enjoué, le propos judicieusement illustré et l'approche éminemment incarnée, ancrée dans les enjeux du travail collectif, des transferts culturels transatlantiques et des liens entre vie académique, vie artistique et vie affective. [...] Au fil de l'entretien, organisé chronologiquement et séquencé avec subtilité, on lit avec bonheur tout l'attachement de Lotringer à une approche expérimentale et décloisonnée des liens entre théorie, fiction, pratique éditoriale et pratique politique. »
Emmanuel Guy,
Critique d'artCette publication s'inscrit dans la collection de livres de poche publiée par Paraguay qui rassemble essais, entretiens et textes de fiction en langue française, en brouillant les frontières académiques entre ces différents genres littéraires.
Avec cette collection, de jeunes auteur.es – critiques, théoricien.nes, artistes, écrivain.es – enquêtent sur le monde contemporain, et en rendent compte dans des écritures engagées, sensibles et expérimentales, pour adresser à un large public la question de l'expérience des œuvres d'art comme forme de contribution à un débat intellectuel et politique. La ligne graphique de la collection est confiée à Eurogroupe, Bruxelles (Laure Giletti et Grégory Dapra).
Philosophe français, Sylvère Lotringer (1938-2021) est le fondateur de
Semiotext(e), maison d'édition indépendante et revue avec laquelle il a importé aux États-Unis, dans les années 1970, la
French Theory, diffusant la pensée de théoriciens français comme
Deleuze et Guattari, Baudrillard,
Virilio, Foucault ou Clastres.
Professeur à l'université Columbia de New York et professeur à l'European Graduate School de Saas-Fee, il est notamment l'auteur, avec Paul Virilio, de
Pure War (1997) et de
The Accident of Art (2005), de
French Theory in America (2001, avec Sande Cohen) et de
d'
Overexposed: Perverting Perversions (2007).
François Aubart (né en 1978) est docteur en esthétique, commissaire d'exposition indépendant, critique d'art et éditeur. Il enseigne l'histoire et la théorie de l'art à l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy. Il est cofondateur de la maison d'édition Même pas l'hiver.
François Piron (né en 1972 à Saint-Brieuc) est commissaire d'exposition, critique d'art, enseignant et éditeur. Il a cofondé la maison d'édition
Paraguay, initialement au sein de l'espace indépendant castillo/corrales (2007-2015). Après avoir dirigé le post-diplôme international de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, il participe aujourd'hui à la conception de la programmation artistique du
Palais de Tokyo à Paris. Il a notamment dirigé les ouvrages
Contre-Vents et
Absalon Absalon.