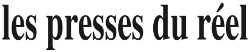Une exploration de l'univers pictural de Luísa Correia Pereira (1945-2009), joyau méconnu du modernisme tardif et « enfant terrible » de la scène artistique portugaise.
« Le Portugal n'est pas un endroit pour les femmes. » Ces mots ont poussé l'artiste Paula Rego à poursuivre des études en anglais, qui ont influencé sa carrière future et son héritage. Quelle aurait été la vie de Luísa Correia Pereira si quelqu'un lui avait dit quelque chose de similaire, étant donné qu'elle était une femme queer dans les années 1970 et 1980 ? Issue d'une dynastie aristocratique portugaise, elle a fui sa famille, poussée par sa quête artistique singulière. À dix-sept ans, en 1962, elle s'est portée volontaire pour travailler à l'Exposition universelle au Brésil, où elle s'est intéressée à la poésie, à la cosmologie et à la biodiversité, autant de domaines qui ont fortement influencé son œuvre.
Luísa Correia Pereira a ensuite passé quelque temps à Paris, au plus fort de la deuxième vague du mouvement féministe, et a étudié la bibliothéconomie, un domaine commun à plusieurs femmes artistes de l'époque. Tout en travaillant à la Fondation nationale des sciences politiques à Paris, elle a développé sa pratique de la peinture après avoir reçu une bourse de la Fondation Gulbenkian. Elle y a été aidée par le célèbre artiste portugais Julio Pomar, qui lui a servi de mentor.
À la suite de la révolution des œillets en 1974, Luísa Correia Pereira est retournée au Portugal, où elle a connu des périodes de reconnaissance avant de tomber dans l'oubli, en partie à cause d'épisodes de maniaco-dépression. La presse l'a surnommée « l'enfant terrible ». Elle était réputée pour sa capacité à attirer les gens dans son orbite, puis à les éloigner tout aussi rapidement, une habitude que peu de gens comprenaient comme étant la conséquence d'un stress post-traumatique complexe. La topographie émotionnelle de sa vie transparaît dans ses premières œuvres sur papier, notamment des aquarelles, des frottages et des collages, qui représentent souvent des paysages surréalistes avec des corps déformés recouverts d'épaisses couches de couleur. Ses toiles ultérieures représentaient des membres amorphes reliés entre eux par des échelles, qui allaient devenir un motif récurrent tout au long de sa carrière.
Dans cet ouvrage, l'auteur et historien culturel Omar Kholeif raconte un voyage de cinq ans à travers une collection d'œuvres de Luísa Correia Pereira. Edité à partir de centaines d'heures d'entretiens réalisés au Portugal, en France et au Brésil, ce premier ouvrage en anglais sur l'œuvre et la vie de l'artiste est à la fois poignant et réconfortant.
Imagine/otherwise est une collection de biographies critiques d'artistes
femmes,
queer ou non binaires, qui ont produit un corpus substantiel d'œuvres mais dont le travail ou la vie n'ont pas nécessairement fait l'objet de publications. Editée par
Omar Kholeif (avec un comité éditorial incluant
Skye Arundhati Thomas, Zoe Butt, Carla Chammas, Alison Hearst et Sarah Perks), la série met l'accent sur la notion de « monde féminin » avec des livres qui servent de guides de terrain dans des vies artistiques précédemment inexplorées, négligées ou inaccessibles. La proposition générale de la série (« imaginer » un monde « autrement ») découle du désir de trouver une autre façon d'écrire sur l'art et de le lire, affranchie des limites imposées par les dominations hégémoniques.
Omar Kholeif (né au Caire, vit et travaille à Chicago et à Londres) est écrivain, curateur, éditeur et présentateur. Ses écrits portent sur l'art dans le contexte de sa mondialisation, et plus particulièrement sur les nouveaux paradigmes nés du développement de l'internet. Il s'intéresse également aux courants artistiques nés des pays émergents et manquant de visibilité. Il collabore notamment avec
The Guardian,
Wired,
frieze, Artforum,
Mousse…