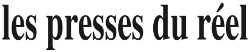Le cinquantième numéro de la revue de philosophie et sciences humaines est consacré à une série de conférences inédites de Jean-Luc Nancy (avec également deux textes hors thème : sur l'image et notre rapport à notre image, actuellement, avec les réseaux sociaux ; et sur le concept d'hyperagence, avec comme exemple type le couple Trump / Musk – hyperagent et fascisme).
Ce numéro du Portique est la matérialisation du projet de publication des conférences de Jean-Luc Nancy, qui eurent lieu à l'Université Européenne de Saint-Pétersbourg, puis à l'Université Russe de l'Amitié des Peuples de Moscou, les 20, 22 et 23 septembre 2016.
En avant-propos, pour ainsi dire, nous présentons un texte de Juan Carlos Moreno Romo, Professeur aux facultés de philosophie et des arts de l'Université Autonome de Querétaro, au Mexique. Dans ce texte il est question de la vie et de la mort, notamment de celle de Jean-Luc Nancy. Il y sera cité des passages clefs de l'œuvre de Nancy, qui seront contextualisés et discutés. De la mort qui nous attend et nous accompagne, jusqu'à l'interrogation d'un certain christianisme de Nancy, Juan Carlos Moreno Romo nous fait traverser cette pensée en la confrontant, entre autres, à celle de Miguel de Unamuno. Un voyage, comme une sorte de préparation aux conférences qui constituent la suite de ce numéro.
Le premier texte, « Dieu sans confession ni profession » est la retranscription en langue française, d'un extrait de la première conférence de Jean-Luc Nancy, publié initialement en langue russe et en langue anglaise. Cette conférence fut donnée dans le cadre de la « Journée Jean-Luc Nancy », à l'Université Européenne de Saint-Pétersbourg, le 20 septembre 2016. Jean-Luc Nancy répond alors à la proposition d'Artemy Magun, de réfléchir sur la signification du terme de « confession », qu'il met en perspective avec ses recherches sur le monothéisme, entendu comme « absenthéisme ».
À la suite de cette conférence, eut lieu le même jour une table-ronde, « Les dieux dans la société matérialiste – qui peut encore nous sauver ? » Cette discussion ouvre à la question de savoir ce qu'est une religion, sans nier l'importance du phénomène religieux dans le monde au cours l'histoire de l'humanité. Cette réflexion débouche sur la question de l'impénétrabilité de la matière, et la nécessité d'une ouverture primordiale à l'autre.
La réflexion de Jean-Luc Nancy se poursuivit alors à Moscou, au sein de l'Université Russe de l'Amitié des Peuples, tout d'abord le 22 septembre, au cours de la conférence : « L'expression « postmoderne » a-t-elle un sens clair (en France et ailleurs) ? ». L'exposé tente de redéfinir une idée du postmoderne d'un point de vue historique et politique, en montrant quelques-unes de ses impasses ou malentendus.
Le lendemain, le 23 septembre, eut lieu la deuxième conférence à Moscou, intitulée « La philosophie aujourd'hui. La question de la technique ». Cette nouvelle et ultime réflexion ouvre la question de la réélaboration aujourd'hui du rapport entre nature et culture.
Puis, nous présenterons les photographies prises au cours de ces différentes interventions, à Saint-Pétersbourg et Moscou. Ce numéro consacré à Jean-Luc Nancy se refermera sur le texte de Denis Viennet, en hommage à Benoît Gœtz, qui fut l'initiateur de cet ouvrage.
Nous proposons ensuite deux articles dans nos Marges et controverses. Le premier, intitulé « Méfions-nous de nos images », nous plonge dans la prépondérance des images sur le discours, bien que nous n'ignorions pas qu'elles se truquent et se manipulent. Nikol Abécassis distingue trois types d'images qui servent le narcissisme humain : 1) images de l'autre-en-souffrance ; 2) images de soi, mais d'un soi comme corps, de préférence sculptural, 3) images recels de « vérité », « qui gardent dans l'ombre le témoignage des violences de l'histoire dont le narcissisme lui-même est la source ». Ce triptyque pictural opère, par un renversement, une disculpation du regardant, car elles montrent quelque chose de lointain ou d'irréel, dans leur vérité/mensonge même, qui permet au spectateur de prendre ses distances avec son éventuelle implication morale par rapport à ce qu'il voit.
Le second texte est d'Antoinette Rouvroy, « Force sans loi ». L'auteure y élabore le concept d'hyperagence. Il s'agit de repenser les rapports entre « capital, technologie, pouvoir institutionnel et imaginaire politique ». En s'appuyant sur une analyse des discours et actes du duo (désormais séparé, semble-t-il) Trump-Musk, l'auteure parvient à dégager les « éléments d'une théorie critique des nouvelles formes d'autoritarisme » qui prennent forme dans le contexte actuel du capitalisme algorithmique et des crises de la démocratie.
Pour finir, vous trouverez également dans ce volume plusieurs recensions sur des thèmes variés.
Laurent Maronneau et Denis Viennet
Créée en 1997 à l'initiative de Benoît Goetz et Jean-Paul Resweber, Le Portique, revue semestrielle de philosophie et sciences humaines, est devenu un véritable lieu de recherche, garant d'une approche transdisciplinaire qui cherche à mettre en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique. Tout en se voulant au carrefour de questionnements et de rencontres, la revue est aussi restée ouverte au grand public, donnant rendez-vous au lecteur sous le Portique, espace ouvert dont la sagesse est conforme au modèle stoïcien d'une pensée du seuil, des degrés et des limites, et qui se risque à penser l'événement.
Jean-Luc Nancy (1940-2021) est l'une des grandes figures de la
philosophie post-moderne.
Professeur de philosophie à l'université de Strasbourg de 1968 jusqu'à son éméritat en 2004, où il a enseigné avec
Philippe Lacoue-Labarthe (avec qui il a publié plusieurs ouvrages), professeur invité aux universités de Berkeley, Irvine, San Diego et Berlin, ancien membre du Conseil national des universités, section philosophie, Jean-Luc Nancy était par ailleurs membre du conseil éditorial des
Cahiers Maurice Blanchot et dirigeait, avec
Mehdi Belhaj Kacem, la collection
Anarchies aux éditions
Diaphanes.
Son œuvre multiple comprend des travaux sur l'ontologie de la communauté et la métamorphose du sens, mais aussi des études sur les arts et la théorie de l'image ainsi que des réflexions sur les aspects politiques et religieux des évolutions du monde contemporain. Ses derniers textes ont cherché à opérer une déconstruction du monothéisme.
Voir aussi
Céline Guillot : Inventer un peuple qui manque : que peut la littérature pour la communauté ? – Blanchot, Bataille, Char, Michaux, Nancy, Agamben.