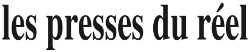S'inscrivant dans une série de publications portant sur des corpus architecturaux singuliers, ce volume met en lumière les constructions hédonistes en bois pionnières de Pierre Lajus dans les années 1970, et redonne à son travail toute sa place dans l'histoire de l'expérimentation architecturale.
Comme le rappelle
Patrick Bouchain, « Au XXe siècle, l'expérimentation a souvent été encouragée, tant pour des raisons de première nécessité, comme après la seconde guerre mondiale, que pour des raisons plus symboliques, comme celle de se donner l'image d'une société innovante. » En architecture, la notion d'expérimentation recouvre des réalités opposées : la grande expérimentation politico-industrielle des modèles constructifs mis en place par le ministère de l'équipement dans les années 60 pour différents programmes de logements ou d'équipements scolaires. Et face à elle, l'expérimentation de l'inventeur, moins balisée, moins totalisante, mais pas moins ambitieuse. L'architecte Pierre Lajus appartient sans consteste à cette dernière catégorie. Au début des années 1970, il invente une architecture hédoniste répondant aux besoins d'une nouvelle société des loisirs issue des trente glorieuses. Sa propre maison regarde du coté des Case Study californiennes, maisons modernistes promues par le directeur de la revue
Arts et Architecture dans les années 60. Lajus troque l'acier dominant ces constructions pour le bois, dont il va faire le matériaux d'une expérimentation se poursuivant par le développement de maisons de week-end économiques autour du bassin d'Arcachon. Ce travail pionnier salué dans les années 1970 mérite d'être remis en lumière à l'heure ou la construction bois redevient centrale dans l'architecture et l'urbanisme. L'ouvrage suit les conseils de Patrick Bouchain, pour qui « redonner à l'œuvre de Pierre Lajus sa place dans l'histoire de l'expérimentation architecturale est aujourd'hui de la plus haute importance ».
A la suite des monographies de
Jean-Patrick Fortin,
Bernard Quirot et
Gilles Perraudin, cette publication s'inscrit dans la collection
Trilogie, qui
propose une nouvelle manière d'appréhender l'architecture à travers la photographie, le texte et le dessin. Ni ouvrage de photographie, ni essai d'architecture, elle s'appuie cependant sur l'image et le texte pour restituer, par les moyens propres à l'objet livre, l'expérience d'une déambulation dans une architecture, du contexte au détail. Chaque numéro porte sur un ou plusieurs bâtiments construits dans un même lieu par un même architecte. Après une première partie de l'ouvrage mêlant texte et image, un dernier cahier de dessins architecturaux – plans, détails, croquis – résout les points aveugles laissés à la lecture ou la vision des photographies. Cet assemblage image-texte-plan constitue une première trilogie. La réunion d'un bâtiment, d'un lieu et d'un architecte est la deuxième trilogie.
Le parti pris de laisser une large place aux photographies, bénéficiant de pleines pages dans un ouvrage en grand format, fait de la collection Trilogie un objet à part dans le panorama éditorial français. Ce parti pris rend hommage à la revue japonaise
GA (
Global Architecture), qui rencontra un grand succès auprès des architectes dans les années 1980-1990. Comme pour cette publication, les photographies sont réalisées exclusivement pour l'ouvrage par un grand nom de la photographie d'architecture. La mise en page établit des continuités visuelles et des oppositions entre le contexte, rarement montré dans les publications architecturales, et l'architecture qui s'y implante. La succession des pages rétablit une séquence et un parcours propre au lieu. L'essai donne des clés de lecture telles que les conditions de la commande, la situation géographique des lieux et les intentions de l'architecte. Il replace l'œuvre en perspective sur la scène architecturale contemporaine.
Après des études à l'École nationale supérieure Louis-Lumière et un voyage initiatique au Japon, Luc Boegly décide de se consacrer à la photographie d'architecture contemporaine et patrimoniale en rejoignant en 1988, comme membre associé, l'agence Archipress, première agence spécialisée en photographie sur l'architecture contemporaine. Il exerce son activité de façon indépendante depuis 2002. Il publie mensuellement dans les revues d'architecture françaises et étrangères. Sa pratique s'articule autour de trois axes : photographie d'architecture, d'exposition, ou photographie scientifique, à travers la constitution de corpus de recherche en architecture et urbanisme en collaboration avec des chercheurs (monographies d'architectes et de villes). Il a notamment publié
Trouville (AAM, Paris, 2020),
La Source – Fondation Carmignac (Jean Boîte, Paris, 2019),
Les Architectes de La Défense (Dominique Carré, Paris, 2011).
Architecte de formation, Olivier Namias a étudié à l'école d'architecture de Paris Belleville et au Politecnico de Milan. Après quelques années en agence, il se tourne vers la presse d'architecture et le commissariat d'exposition, avec une prédilection pour les sujets croisant l'architecture et la société, tels ses travaux sur l'architecture et l'électricité (architecture des réseaux électriques parisiens et l'introduction de la lumière électrique dans l'architecture, les paysages de l'énergie). Il a été commissaire de l'exposition
Hôtel, présentée au pavillon de l'Arsenal en 2019, et de l'exposition
Survols, présentée au CAUE en 2018, portant sur la représentation de la ville dans la photographie aérienne.
Né à Bordeaux en 1930, Pierre Lajus intègre l'école régionale d'architecture de Bordeaux dont il sort diplômé en mars 1956. Il complète cette formation par un cursus à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris entre 1957 et 1961, devenant assistant de l'architecte urbaniste Michel Écochard (1905-1985) tout en développant sa propre agence. Il passe deux ans en Guinée sur le projet de la ville nouvelle de Fria, et rentre à Bordeaux en 1962. Associé à Yves Salier (1918-2013), Adrien Courtois (1921-1980), et Michel Sadirac (1933-1999), il se consacre principalement à des commandes d'habitat individuel pour une clientèle locale, composée de professions libérales, d'artisans et chefs d'entreprise. Au sein de l'atelier, sa production se distingue par l'utilisation du bois et la recherche de solutions économiques industrialisables, aboutissant à la maison modèle Girolle, basée sur un système de charpente bois préfabriqué. En 1974, il créé sa propre agence et occupe des fonctions plus institutionnelles ou prospectives : Groupe de réflexions sur l'architecture individuelle (Groupe Racine) ou l'industrie mise au service de l'architecture. Il est nommé directeur adjoint de l'architecture en 1984, poste qu'il occupe trois ans en tandem avec Jean-Pierre Duport. Il cesse son activité d'architecte en 1995, et publie le célèbre ouvrage « l'architecture absente de la maison individuelle » pour le compte du PUCA en 1997. Il vit dans la métropole bordelaise dans la maison qu'il s'est fait construire en 1973. Son œuvre compte de nombreuses maisons individuelles (700 « Girolles »), des opérations d'habitat mixte ou des équipements publics tel le centre permanent d'initiation à l'environnement du Tech, dans le parc naturel des Landes de Gascogne.