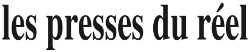Que se passe-t-il lorsque des graphistes contemporains semblent vouloir reprendre le flambeau de l'iconographie que des artistes dits iconographes avaient déjà récupéré depuis le début du siècle dernier des graphistes, de leur culture ou de leurs compétences ? (par
Thierry Chancogne).
Scène 1 : le peintre-iconographe « décrit tout sujet par le dessin ». Au sein d'un atelier ou « sur le motif », soit en pleine nature, il produit une image d'après un objet. Il travaille déjà à ce qu'Erwin Panofsky appelle des iconographies.
Scène 2 : le peintre-iconographe produit une image à partir d'une image ou d'un texte imagé, d'une peinture, d'une photographie ou même d'une ekphrasis. C'est-à-dire de la représentation textuelle la plus complète possible d'une image qui fut longtemps un des moyens majeurs de sa diffusion.
Scène 3 : l'artiste, et non plus exclusivement le peintre-iconographe, choisit une image préexistante, une image « déjà faite » – pour ne pas dire « ready made ». En cela, l'artiste s'inscrit dans le corps des métiers liés à la multiplicité des images. L'artiste devient une sorte de documentaliste, de conservateur, de directeur artistique, d'éditeur : d'iconographe dans le genre de ce que des graphistes typographes ont revendiqué depuis longtemps comme moyen propre de régénérer la vieille illustration.
Scène 4 : que se passe-t-il donc lorsque des graphistes contemporains semblent vouloir reprendre le flambeau de l'iconographie que des artistes dits iconographes avaient déjà récupéré depuis le début du siècle dernier des graphistes, de leur culture ou de leurs compétences ?
Faire – Regarder le graphisme est une revue critique bimensuelle consacrée au
design graphique, qui paraît en librairie au numéro ou sous la forme de recueils de plusieurs numéros. Editée par
Empire, la maison d'édition du studio
Syndicat, elle s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs et aux professionnels, en documentant les pratiques contemporaines et internationales du graphisme ainsi que l'histoire et la grammaire des styles. Chaque numéro propose un sujet unique et tentaculaire, traité par un auteur reconnu.
« Les revues critiques dédiées à l'analyse du design graphique sont malheureusement trop peu nombreuses aujourd'hui, particulièrement en France mais aussi en Europe. Engagés dans une posture analytique et critique des formes et activités du graphisme, Sacha Léopold et François Havegeer souhaitent mener une revue imprimée sur ces pratiques, en agissant avec sept
auteurs (Lise Brosseau, Manon Bruet,
Thierry Chancogne, Céline Chazalviel,
Jérôme Dupeyrat, Catherine Guiral et Étienne Hervy). Ce choix restreint, lié à la volonté de proposer une expérience au sein d'un groupe ayant déjà mené des projets communs, permettra d'inclure des auteurs internationaux la deuxième année. »